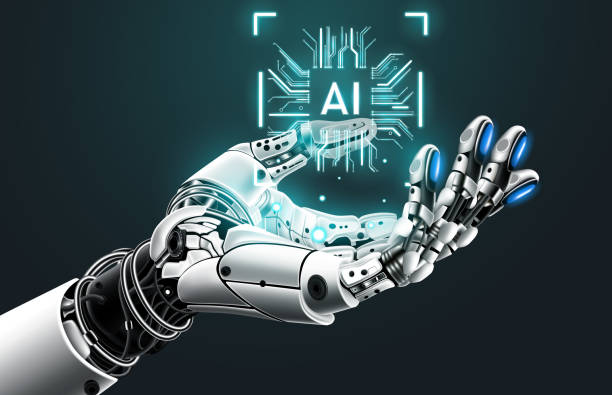Avec les «Facebook files», cette série d’enquêtes publiées ces dernières semaines par le Wall Street Journal, puis l’audition mardi au Sénat américain de celle qui en est à l’origine et accuse l’entreprise de faire primer «le profit sur la sûreté» de ses utilisateurs, l’ingénieure Frances Haugen, ce n’est certes pas la première fois – très loin s’en faut – que la firme de Menlo Park se retrouve dans la tourmente médiatique et sous un feu de critiques.
On se souvient des reproches essuyés après la découverte des campagnes d’influence menées pendant la présidentielle américaine de 2016 par l’Internet Research Agency, une «ferme à trolls» russe ; et tout autant de l’explosion, début 2018, du scandale Cambridge Analytica, du nom de cette firme de «marketing politique» accusée d’avoir siphonné les données de 87 millions d’utilisateurs à des fins de propagande pro-Trump et pro-Brexit. Sans compter moult reproches d’avoir laissé prospérer les discours et campagnes de haine, en particulier contre les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie victime de nettoyage ethnique. Au vrai, on ne compte plus, ces dernières années, le nombre de fois où les mots «Facebook» et «scandale» ont été accolés.
Pourtant, on ne croit pas avoir entendu, même au plus fort de la «séquence» Cambridge Analytica, des mots aussi durs, et aussi unanimes, dans la bouche des parlementaires de Washington, que ceux prononcés mardi. «Voici mon message à Mark Zuckerberg, a tonné le sénateur démocrate du Massachusetts Edward Markey. L’époque où vous pouviez envahir notre vie privée, promouvoir des contenus toxiques et vous en prendre à des enfants et des adolescents est révolue.» Son collègue républicain du Mississippi Roger Wicker a parlé sans détour de «faillite morale». L’entreprise pouvait bien riposter, évoquant des documents sortis de leur contexte, et «Zuck» en personne publier un long plaidoyer pro domo appelant in fine le Congrès à légiférer, qui les entendait encore ?
Pour celles et ceux – de plus en plus nombreux avec les années – qui dénoncent le modèle économique de Facebook, l’opacité de ses algorithmes, et plus généralement la prédation des données personnelles par les grandes plateformes numériques, leurs incitations à la viralité et leurs effets de polarisation, les révélations de Frances Haugen ne sont malheureusement pas une surprise. Mais elles sont le fait d’une voix venue de l’intérieur qui, mardi, dressait en termes clairs la big picture d’un mastodonte obsédé par sa propre croissance, l’œil rivé sur l’«engagement» de ses utilisateurs – partages, likes, commentaires, etc. – et réagissant trop peu, trop tard, voire pas du tout aux alertes sur les effets délétères de ses outils.
Le passif était déjà lourd ; plus encore que les enquêtes sur la gestion discrétionnaire des profils «VIP» ou les lacunes de la modération au Mexique ou en Ethiopie, c’est celle accusant Facebook d’avoir pleinement conscience, via ses propres recherches, de l’impact négatif d’Instagram sur nombre d’adolescentes qui a mis le feu aux poudres.
Nul ne sait sur quoi déboucheront les huit plaintes de Frances Haugen contre le géant de Menlo Park devant l’organisme de contrôle des marchés financiers, ni ce qu’il adviendra des promesses des sénateurs assurant que le Congrès «va agir». Il peut y avoir loin de la coupe aux lèvres, d’un épisode médiatique désastreux à la remise en cause d’une puissance économique. Mais l’image de Facebook semble plus atteinte encore qu’en 2018 ; et d’évidence, il ne se trouve plus grand monde, en dehors de l’entreprise elle-même, pour nier ou minorer les problèmes, politiques et sociaux, que posent son modèle et ses choix. Jamais les appels à la régulation n’ont été aussi pressants. Les «Facebook files» ne sont pas seulement un scandale de plus. Ils sont peut-être, à l’échelle des opinions publiques en tout cas, le scandale de trop.
Amaelle Guiton, dans Libération