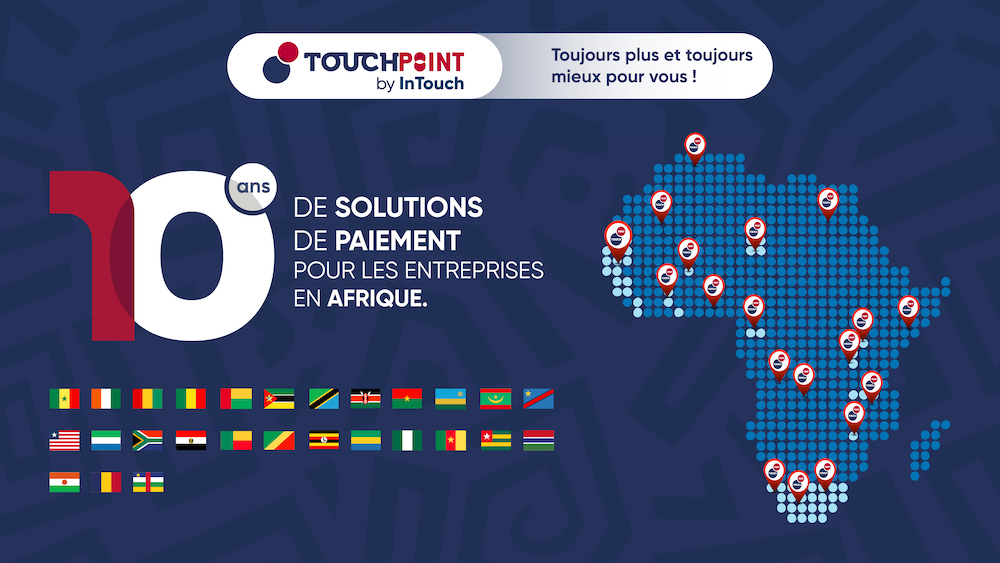Le phénomène de la désinformation, amplifié par la puissance virale des plateformes numériques, constitue aujourd’hui un défi majeur pour les sociétés démocratiques.
De la manipulation politique à la remise en cause de la santé publique, les fake news ou fausses nouvelles sont devenues des armes redoutables entre les mains d’acteurs malveillants.
Dans ce contexte, les propos récents du Premier ministre Ousmane Sonko, tenus à l’Assemblée nationale le 14 avril 2025 « désormais la politique pénale c’est zéro tolérance à la matière, diffusion de fausse nouvelle zéro tolérance, on garantit à tout le monde la liberté d’expression mais on ne garantit pas ce qui va suivre après… »
Mais la lutte contre la désinformation ne saurait être menée au détriment des libertés fondamentales, à commencer par la liberté d’expression.
Le cadre juridique actuel, notamment l’article 255 du Code pénal sénégalais, soulève à cet égard plusieurs interrogations.
-
DÉFINIR LA DÉSINFORMATION : UN DÉFI JURIDIQUE ET POLITIQUE
Le terme « fake news » recouvre une réalité plus complexe qu’il n’y paraît. En l’absence de définition universellement reconnue, plusieurs typologies académiques ont tenté d’éclaircir le concept. Parmi elles, la classification tripartite suivante :
- Désinformation : diffusion intentionnelle d’informations fausses dans le but de nuire.
- Mésinformation : diffusion involontaire d’informations inexactes.
- Malinformation : diffusion d’informations véridiques mais dans l’intention de nuire.
Les technologies numériques — intelligence artificielle générative, deepfakes, algorithmes de viralité — ont démultiplié l’impact de ces pratiques, brouillant davantage les frontières entre le vrai, le faux et le malveillant.
Dès lors, la question n’est plus seulement de réguler les contenus, mais de comprendre les intentions, les contextes et les effets.
-
L’ENCADREMENT JURIDIQUE ACTUEL : L’ARTICLE 255 DU CODE PÉNAL
Au Sénégal, la lutte contre la désinformation repose principalement sur l’article 255 du Code pénal. Ce dernier dispose :
«la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement».
Cette disposition érige en infraction la diffusion de fausses informations, indépendamment de l’intention de nuire.
L’article 255 prévoit une sanction pénale « d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs ».
Si l’existence d’un cadre juridique spécifique témoigne d’une volonté de l’État de contenir la propagation de fausses informations, l’article 255 présente néanmoins de sérieuses insuffisances qui en limitent l’efficacité et la légitimité :
Le texte ne précise pas les critères permettant d’établir objectivement qu’une information est fausse. Il ne distingue pas entre erreur factuelle, opinion controversée ou mensonge délibéré.
Il ne précise pas non plus le seuil requis pour déterminer si le moral de la population a été atteint ou si les institutions publiques ont été discréditées.
La disposition criminalise la diffusion même non intentionnelle de fausses informations, ce qui revient à faire peser une responsabilité pénale sans exigence de mauvaise foi en contradiction avec le principe fondamental du droit pénal.
-
LES RÉPONSES À LA DÉSINFORMATION NE DOIVENT PAS PORTER ATTEINTE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
S’il est vrai que le développement de l’internet a contribué à multiplier la manipulation de l’information sur la politique, sur les droits humains notamment le droit à la santé, le droit à une information de qualité entre autre, il faut souligner que, les réponses juridiques ou politiques insuffisamment élaborées pour répondre à la désinformation peuvent, elles-mêmes, présenter des risques sérieux d’atteinte aux droits de l’homme, en particulier la liberté d’expression, et l’accès à l’information en restreignant un large éventail de discours, en promouvant l’autocensure. En conséquence, les sanctions prévues pour punir les manquements à la loi sont parfois disproportionnées.
Les normes internationales sur la question stipulent clairement que toute restriction de la liberté d’expression doit remplir trois conditions cumulatives :
- Être prévue par la loi (légalité) ;
- Poursuivre un ou plusieurs buts légitimes (légitimité) ;
- Être nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique qu’elle soit proportionnée à l’objectif légitime poursuivi (nécessité).
Ainsi, il en ressort de l’analyse de l’article 255 du code pénal la formulation demeure vague et que les peines maximales applicables à l’infraction de publication ou de diffusion de fausses nouvelles sont disproportionnées.
Dès lors, il demeure important pour le gouvernement du Sénégal d’adapter cet article aux conventions internationales auxquelles le Sénégal a souscrit afin qu’il réponde aux exigences internationales.
Baba Fall BADIANE, Juriste Chez SCP LEGALIX