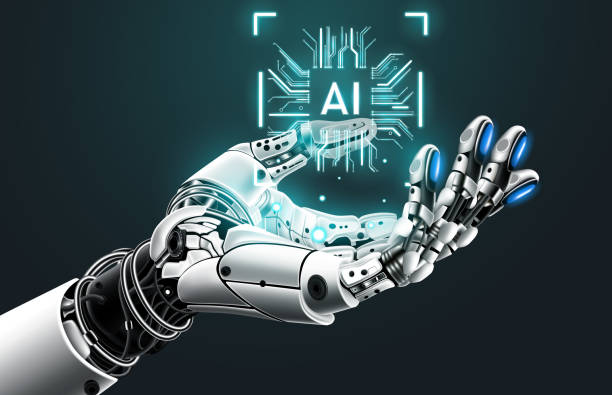Vous qui évoluez sur trois continents et au moins autant de langues, quel rapport entretenez-vous avec la langue française ?
Le français, c’est ma langue et c’est probablement la langue que je parle le mieux. Je fais partie de la génération née autour des indépendances, celle des enfants de Léopold Sédar Senghor (l’écrivain et poète fut le premier président de la République du Sénégal, de 1960 à 1980, NDLR). Nous sommes les enfants de sa politique éducative et donc nous sommes une génération qui s’est installée directement et immédiatement dans la langue française. À l’école, j’ai reçu une instruction de quelqu’un dont le français était la langue. Donc, tout naturellement, on partait du principe que le français était notre langue.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Au Sénégal, les générations qui nous ont succédé ont appris le français comme on apprend une deuxième langue. Et ça, ça change tout : elles ont un rapport plus distant au français. C’est encore leur langue mais c’est la langue de l’école.
Considérez-vous le français comme votre langue natale ?
J’ai parlé le français à peu près en même temps que le wolof et cela pour une raison très simple. Je suis né à Saint-Louis du Sénégal (au nord pays, NDLR). Mais avec mes parents, nous sommes ensuite allés à Ziguinchor (au sud-ouest du Sénégal, au bord du fleuve Casamance, NDLR). Or, à l’époque, Ziguinchor n’était pas une ville où l’on parlait le wolof. Tout le monde s’adressait à nous en français. Nous nous sommes donc installés dans la langue française parce qu’elle était la langue commune dans notre entourage. J’ai donc parlé en même temps le français, le wolof, et je me suis mis également aux deux langues locales de Ziguinchor, c’est-à-dire le créole et le diola. Malheureusement, ces deux dernières langues, je les ai oubliées. Il ne m’en reste que des traces.
Vos contemporains ne sont-ils pas surpris de vous entendre dire que le français est votre langue ?
Aujourd’hui, il est de bon ton d’insister sur le fait que cette langue est venue avec la colonisation. Cela est vrai. Mais il suffit de m’entendre parler pour se rendre compte que c’est ma langue. J’entretiens un rapport heureux avec la langue française. Je connais beaucoup de poèmes et j’écris avec bonheur dans cette langue. Voilà ce que signifie le fait de dire que le français est ma langue. J’ai aussi un rapport heureux avec ma langue wolof, comme j’ai développé un rapport heureux avec la langue anglo-américaine.
Comment définiriez-vous la Francophonie ?
Dans l’esprit de Senghor, la Francophonie devait être une grande organisation centrée autour d’une langue commune. Il est intéressant de se rappeler sa formule de « Commonwealth à la française » alors que le Commonwealth qui est, en quelque sorte, le concurrent de la Francophonie, n’indique aucune centralité de la langue anglaise, ne s’appelle pas « anglophonie ». Il y est simplement question de partenariats, même si le Commonwealth regroupe des pays qui dans le passé faisaient partie de l’Empire britannique. D’ailleurs, des pays en principe francophones comme le Togo, le Gabon ou le Rwanda ont rejoint le Commonwealth car ils ne voient pas l’aspect langue, mais l’organisation, le commerce, le partenariat économique…
Dans l’idée de Senghor, la langue vient d’abord, avec elle la culture et, tout naturellement, les partenariats suivent. Mais cette idée n’est plus aussi vraie. Cela aussi représente un changement. Selon moi, la Francophonie devrait permettre de créer des partenariats autour d’une langue commune. L’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) est un exemple d’organisation bâtie autour d’une langue commune puisqu’elle regroupe des universités dont la langue est le français. La Francophonie essaie continuellement de se définir. Elle revêt une signification géopolitique et pas seulement linguistique, culturelle, scientifique.
« Dans un monde pluriel, postcolonial, pourquoi vouloir l’universel ? » vous avait demandé en 2010 l’écrivain et penseur antillais Édouard Glissant, comme vous l’écrivez dans votre nouvel ouvrage Universaliser, l’humanité par les moyens d’humanité (Albin Michel). De même, pourquoi vouloir la Francophonie ?
La Francophonie elle-même doit se poser cette question. Il est nécessaire pour ce genre d’organisation de garder cet idéalisme selon lequel partager une langue, partager une culture, doit tout naturellement se traduire aussi par des partenariats solides, des valeurs communes, etc. Il faut évidemment garder cette orientation première. Mais il convient d’interroger la forme qu’elle doit revêtir et sa signification dans le monde où nous vivons.
Parce qu’aujourd’hui précisément, on observe une remise en question de tout ce qui peut ressembler à des liens néocoloniaux. Beaucoup perçoivent que ces liens se poursuivent dans l’organisation de la Francophonie qui elle-même est remise en question. La Francophonie doit donc trouver le moyen de se redéfinir, de se donner une orientation nouvelle. Elle doit réfléchir à la meilleure manière de mettre en place un véritable partenariat entre les pays du Nord et les pays du Sud, un partenariat gagnant-gagnant, comme on dit maintenant dans le langage du commerce, un partenariat à égalité.
Il convient d’évoquer aussi l’éléphant dans la pièce, c’est-à-dire la langue anglaise et l’attraction qu’elle exerce. Il fut une époque où, tout naturellement, les pays francophones disposaient du français comme langue d’ouverture sur l’international. Ce n’est plus le cas. Je connais personnellement le Sénégal. Les classes moyennes supérieures y mettent leurs enfants directement dans des écoles anglophones, américaines, americano-sénégalaises, etc. Le choix de la langue anglaise comme langue d’éducation se fait relativement tôt.
Le monde francophone africain qui se tourne vers l’anglais ne fait que suivre une grande tendance mondiale, laquelle tendance mondiale est à l’œuvre aussi en France. À Sciences Po, par exemple, une grande partie des études est conduite en anglais. J’ai été personnellement invité pour donner des séminaires à la Sorbonne… en anglais. Pour quelle raison ? Dans le monde, les classes moyennes se sont développées et la demande d’éducation comme d’enseignement supérieur s’est très fortement accrue. En particulier, vous avez beaucoup d’étudiants indiens ou chinois qui sont demandeurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on prête la plus grande attention aux classements des universités, le classement de Shanghai, car il s’agit d’attirer ces masses d’étudiants en quête d’une formation. Le meilleur moyen de les attirer, c’est d’aller à leur rencontre dans la langue qu’ils parlent.
Voilà les conditions dans lesquelles il faut penser l’avenir de la Francophonie. Comment développer un système d’enseignement supérieur, une science, une recherche en français ? Ce sont les grandes questions qu’il faut se poser à un moment où l’attraction de la langue anglaise est réelle dans tous les pays francophones, et pas seulement dans les pays francophones du Sud, dans ceux du Nord également.
Mais l’anglais est « la langue hypercentrale » selon votre expression dans De langue à langue, l’hospitalité de la traduction (Albin Michel). Elle est aussi une langue de la colonisation.
Il faut souligner ce paradoxe. Cette langue est tellement hypercentrale que l’on perd de vue le fait qu’elle est la langue d’une puissance qui était une puissance coloniale. Ainsi, le fait que l’hypercentralité de l’anglais soit plutôt celle de l’anglo-américain (l’Amérique n’étant pas considérée aujourd’hui comme faisant partie des anciennes puissances coloniales), contribue à rendre la relation à cette langue différente de celle que l’on entretient avec la langue française.
Dans une conférence internationale, par exemple, les participants viennent de langues différentes et se rencontrent dans la langue anglaise. Du fait de son hypercentralité même, l’anglais perd de sa charge coloniale. Cela étant, un écrivain comme le Kenyan Ngugi Wa Thiong’o a décidé de ne plus écrire en langue anglaise mais en kikuyu (parlée principalement par l’ethnie Kikuyu, au Kenya, NDLR).
Cela m’amène à un autre point : je crois que la force de la Francophonie réside dans sa littérature qui continue de s’enrichir. Il existe une littérature francophone diverse, qui enrichit la langue française et qui est le trésor de la Francophonie, au-delà des questions institutionnelles et géopolitiques. À ce propos, je me dois de mentionner le prix Goncourt de mon neveu, au sens africain du terme, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr (pour La plus secrète mémoire des hommes, NDLR).
Vous parlez également d’« orature » en expliquant, autre paradoxe, que le français a permis la pérennité de certaines œuvres de la littérature orale africaine.
Effectivement, des écrivains comme Senghor et Abdoulaye Sadji ont mis des contes à l’écrit. Je viens moi-même d’écrire la postface d’un beau livre de Kaïdara, ce conte traditionnel et très mystique peul que l’écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté Ba a transcrit et traduit, qui a connu une fortune internationale. Il fait désormais partie de la littérature mondiale.
Il existe deux manières de voir les choses. Une attitude postcoloniale hostile à la langue française voit dans la traduction de la littérature orale une sorte de reddition. Les tenants de cette position considèrent que ce serait rendre les armes que d’exister dans cette langue impériale.
La position qui est la mienne consiste à dire que ces auteurs qui traduisent leur imaginaire en écrivant dans la langue française ne sont pas doloristes, ne ressentent pas une douleur en se disant « je suis obligé de parler la langue coloniale ». Au contraire ! ils connaissent le rapport que tout écrivain entretient à la langue qui est la sienne, qu’il fait sienne : un rapport presque jubilatoire. Ils ont plaisir à écrire. Ce plaisir de l’écriture fait la qualité et la valeur de la littérature francophone.
Je veux insister sur le fait que la force de la Francophonie est dans sa littérature. C’est là qu’elle est vivante. C’est là qu’est son avenir. A-t-elle aussi un avenir comme organisation institutionnelle, géopolitique, etc. ? La question est posée.
Vous plaidez pour une plus grande ouverture de la Francophonie à d’autres langues africaines.
Nous avons nos langues. Nous ne devons pas nous retrouver devant une alternative qui serait de parler nos langues africaines ou le français. La réalité de beaucoup de pays nous invite à avoir une approche beaucoup plus nuancée que cela.
Dans un pays comme le Sénégal, où le wolof joue le rôle de lingua franca, il n’ y a aucune pression à parler français, vous pouvez parler en wolof même dans l’administration. En revanche, d’autres pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, etc. ont tellement de langues que le français est devenu une lingua franca par la force des choses. Donc mettre en œuvre des politiques de pluralisme linguistique ne veut pas dire adopter un modèle unique à appliquer partout.
Les orientations doivent épouser les courbes du terrain et la nature des pays. L’avenir s’inscrit dans le développement commun de plusieurs langues, de toutes les langues qui cohabitent à l’intérieur de l’espace dit francophone. Il ne s’agit pas seulement d’accuser l’impérialisme ou le colonialisme. Il est de la responsabilité des différents pays de mettre en œuvre les politiques de pluralisme culturel qui conviennent à leur propre situation : l’enseignement fera ainsi, par exemple, dans un pays comme le mien, toute leur place aux langues nationales, au français, à l’arabe, à l’anglais aussi, bien entendu.
Comment faire pour que le français reste la langue des peuples et non celles des pouvoirs parfois non démocratiques, comme le regrettait l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou ?
La réponse est précisément dans le pluralisme linguistique. Il faut profiter de la richesse que représente le fait de parler plusieurs langues et ne pas penser qu’on affirme mieux son identité en s’amputant d’une des langues qui est une composante essentielle de cette identité.
Cependant, dans le paysage linguistique d’un pays, le français ne doit pas être la langue la plus prestigieuse parce qu’elle est la langue de l’école, de l’administration, etc. Les autres langues aussi doivent se développer et acquérir le prestige qui leur revient. L’écrivain aussi a une responsabilité. La langue de Mabanckou retrouve parfois la langue de Pointe-Noire, ainsi des manières de parler qui ne sont pas nécessairement le français canonique.
C’est la force des écrivains de faire en sorte que la manière dont le peuple lui-même s’est approprié la langue française soit valorisée. Je pense aussi au théâtre ivoirien qui fait un usage magnifique de ce qui est aujourd’hui un vrai « français ivoirien » que l’on entend également dans la musique du groupe Magic System.
Cette créativité-là permet une véritable appropriation populaire de la langue française et c’est tant mieux. Le français découvre sa propre capacité à être multiple, à se dire de manière différenciée selon les pays et les peuples.
À l’intérieur de la France même aussi cohabitent un usage savant de la langue et un usage populaire, et c’est normal. L’expansion de la langue française explique sa diversification.
En conclusion, quelle personnalité institutionnelle, politique ou artistique de la Francophonie avez-vous envie d’évoquer ?
J’hésite beaucoup, mais je voudrais insister sur deux figures : Senghor que j’ai déjà évoqué, parce que je le connais bien, aussi l’écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, qui me parle beaucoup. D’abord parce que, elle et moi avons été brièvement collègues à l’université de Columbia à New-York. Je la connaissais évidemment par ses écrits et son parcours, mais à Columbia, je l’ai connue personnellement. C’est une femme pour laquelle je garde la plus grande admiration, pour sa manière de se reconnecter avec le continent africain.
Maryse Condé représente un trait d’union entre la Caraïbe et l’Afrique. Elle s’est investie dans l’histoire de l’Afrique de l’Ouest, avec des déceptions évidemment parce que les indépendances n’ont pas tenu les promesses qui étaient les leurs.
Cette recherche permanente qui a été la sienne d’une identité à la fois dans les Caraïbes et sur le continent africain, en Afrique de l’Ouest, d’une identité qu’elle porte dans son nom (elle porte le nom de l’homme qu’elle a aimé) et d’une identité qu’elle se crée aussi par l’écriture, tout cela m’attire beaucoup et donne une signification à la Francophonie.
Propos recueillis par Françoise Marmouyet et Victoire N’Sondé.
Cet article est publié en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie à l’occasion du XIXe sommet de la Francophonie qui se tient les 4 et 5 octobre 2024 à Paris et Villers-Cotterêts.![]()
Souleymane Bachir Diagne, Professeur dans les départements d’Études francophones et de Philosophie, directeur de l’Institut d’Études africaines (IAS), Columbia University
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.