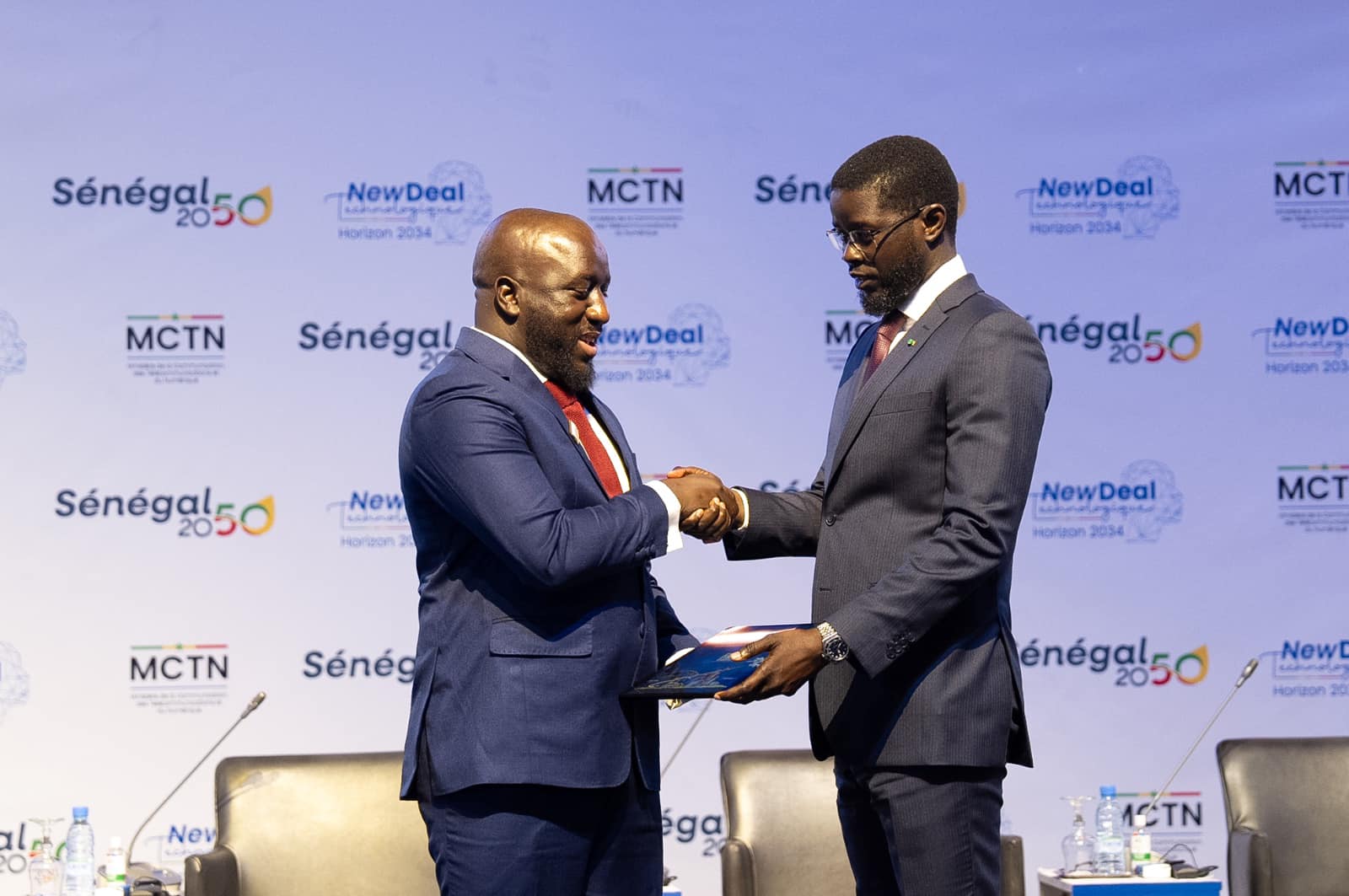Il y a environ 8 milliards d’humains en 2022, dont 50 % de femmes. Ces dernières, bien qu’aussi nombreuses que les hommes, sont sous-représentées dans les domaines scientifiques.
Aussi, parmi les 956 lauréats du prix Nobel, compte-t-on seulement 60 femmes, soit 6 % : les différences entre les femmes et les hommes seraient-elles de nature à justifier une telle disparité ?
Des différences naturelles ?
La première différence est chromosomique. L’être humain a 23 paires de chromosomes, la dernière paire étant différente selon le sexe : 2 chromosomes X pour les femmes, et un chromosome X et un chromosome Y pour les hommes. Cette différence chromosomique rend compte de celle des organes génitaux, différenciables dès la naissance dans plus de 99 % des cas. À cette différence génétique, s’en ajoute une autre : celle de genre.
Le genre est une norme sociale qui définit la manière dont nous devons, selon notre sexe, nous comporter (manières de prendre la parole, de s’asseoir, de marcher, de danser, etc.). Les normes varient : au 1VIIe siècle en France, les hommes fortunés portaient des chaussures à talon, à l’image de leur positon sociale élevée. En Europe aujourd’hui, à l’exception des Écossais, peu d’hommes portent des jupes. Mais, en Asie, la jupe est très répandue chez les hommes. Ces variations dans le temps et dans l’espace montrent que, dans l’expression de caractéristiques genrées, ce qui compte n’est pas le sexe de la personne, mais, avant tout, le contexte social et culturel.
Le genre se définit aussi par des stéréotypes sur des compétences et des aptitudes, souvent considérées comme innées, dont on verra qu’ils expliquent largement pourquoi les femmes sont si peu présentes dans les sciences.
On sait que, dès le plus jeune âge, l’environnement des garçons et des filles diffère en fonction de ces stéréotypes. Pourtant, à l’entrée en CP, les filles sont meilleures que les garçons en français et aussi performantes que les garçons en maths. Or, à l’université, on ne trouve que 22 % de mathématiciennes. Que s’est-il passé pour que presque toutes les femmes se détournent des mathématiques ? Un ensemble de phénomènes qui vont agir à la fois sur les femmes elles-mêmes, les stéréotypes, mais aussi sur les professeur·e·s, les recruteur·ses et les parents, les biais de genre.
La puissance des stéréotypes
Les stéréotypes sont des traits de caractère, des capacités qui vont être attribuées de manière arbitraire à un groupe de personnes. S’ils n’ont aucun fondement scientifique, ils vont néanmoins influencer la manière dont se comportent les individus.
Aussi, les filles vont-elles intégrer, très tôt, l’idée selon laquelle elles ne sont pas faites pour les maths. Ces stéréotypes genrés ne sont pas récents. À la Renaissance, période noire pour l’égalité entre les femmes et les hommes, les femmes ont été exclues des domaines culturels, économiques, et politiques. Puis au siècle des Lumières, les noms féminins des professions intellectuelles et artistiques (autrice, peintresse, poétesse, doctoresse…) ont été supprimés par l’Académie Française rendant légitime l’absence de femmes au sein de ces professions.
Or, des chercheuses et chercheurs de l’université d’Aix-Marseille ont testé les compétences en mathématiques d’enfants des deux sexes âgés de 12 ans séparés en deux groupes. Dans l’un, la consigne donnée aux enfants était qu’ils allaient faire un test de géométrie. Dans l’autre, la consigne était qu’ils allaient faire un test de dessin. Dans le groupe « test de géométrie », les garçons ont mieux réussi que les filles, alors que dans le groupe « test de dessin », ce sont les filles. Alors que le test est le même, les filles sont moins performantes quand on leur dit qu’elles passent un test de géométrie. C’est donc l’évocation de la géométrie qui constitue un obstacle, et non pas des différences de capacités, puisque, dans la consigne « test de dessin », elles sont meilleures que les garçons.
C’est l’effet du stéréotype : on observe des baisses de performances dans les situations où les individus craignent de confirmer un stéréotype négatif attribué au groupe auquel ils appartiennent. On parle de la menace du stéréotype. Alors que le stéréotype en lui-même n’a pas de fondement biologique (au niveau cérébral, les cerveaux de deux hommes ont autant de différences que le cerveau d’un homme et d’une femme, il induit chez celles et ceux qui en sont la cible un comportement qui s’y conforme : les femmes vont être moins sûres d’elles-mêmes, et se sentir moins légitimes dans des disciplines dont les stéréotypes les excluent, comme les maths, et les sciences de manière générale.
Les stéréotypes vont également induire des biais chez celles et ceux qui vont enseigner, juger, évaluer et recruter. Une étude a montré que pour un même CV, on va juger un candidat (prénom de garçon) plus compétent qu’une candidate (prénom de fille), et on va lui proposer un meilleur salaire. C’est ce qu’on appelle un biais de genre : on traite différemment des personnes, non pas en raison de leurs compétences ou de leurs qualités, mais en raison de leur genre.
L’exclusion des femmes des carrières scientifiques et ses mécanismes
L’inégalité de genre, constatée à l’entrée dans les études scientifiques, s’amplifie tout au long de la carrière. Bien que leur nombre soit en augmentation, les femmes restent encore minoritaires chez les enseignant·e·s-chercheur·ses, toutes disciplines confondues (40 % en 2021), mais de manière plus prononcée en sciences (à la même date, 34 % de maitresses de conférences et 19 % de professeures en sciences et techniques).
Cette érosion est décrite et analysée dans le documentaire Picture a scientist.
Puisque, comme souligné plus haut, les femmes sont dotées des mêmes capacités que les hommes, auraient-elles une moindre appétence pour les sciences ?
Il est significatif de remarquer les importantes variations d’un pays à l’autre de la part des femmes dans les cursus scientifiques. Et, apparent paradoxe, elles sont d’autant plus exclues que le pays est égalitaire. En effet, les femmes qui parviennent à faire des études dans les pays où elles doivent se battre pour y accéder ont déjà accompli un choix transgressif, si bien que leur orientation disciplinaire est plus libre. On voit que ces variations s’expliquent par le contexte et, comme évoqué supra, non par le recours à des différences naturelles selon le genre. Dans les pays où l’accès des femmes aux études n’est pas en question, le stéréotype joue dans le choix des disciplines. Il impacte aussi globalement les résultats aux épreuves, selon le mécanisme connu sous le nom de menace du stéréotype décrit plus haut.
Aussi, dans les grandes écoles scientifiques en France, le pourcentage de femmes est-il très faible, notamment à l’ENS-PSL (École normale supérieure) comme cela a été décrit dans l’étude : Filles + sciences = une équation insoluble ?. L’analyse des bulletins scolaires, en fonction de l’origine sociale et du genre, est précieuse. Elle montre que les appréciations genrées, dont on n’est pas nécessairement conscient, sont monnaie courante. Une formation spécifique des enseignant·e·s est donc souhaitable pour limiter ces biais.
Ce phénomène ne se limite pas aux études. Le comportement des jurys de promotion au CNRS, a été analysé par I. Régner : ce n’est pas le biais implicite qui est responsable de l’inégalité en termes de promotion de femmes, mais sa non-reconnaissance.
Pourquoi agir et comment le faire ?
Il s’agit d’œuvrer pour plus d’équité à l’échelle individuelle et sociale, mais aussi pour plus d’efficacité : dans la recherche académique, mais aussi l’industrie et dans l’éducation, plusieurs études ont montré que les groupes mixtes (genre, origine sociale…) sont plus performants.
Il faut donc tirer profit de ce constat à l’échelle globale. Il s’agit, face aux défis scientifiques auxquels nous sommes confrontés, de ne pas perdre 50 % des cerveaux.
Il faut par conséquent informer et convaincre des effets délétères des biais de genre qui sont plus communément répandus qu’on ne le croit généralement. Un moyen de s’en rendre compte est de réaliser un test d’association implicite : on mesure alors la force de ce biais dans la difficulté, via la lenteur, à associer « homme » et « lettres », « femme » et « sciences ».
Un effet pervers doit être mentionné : si la représentation dans les instances universitaires est paritaire, ce qui est souhaitable, on observe cependant des effets d’épuisement sur les carrières des femmes. En effet, dans la mesure où, notamment pour les rangs A (professeures), le vivier reste inégalitaire, les femmes se trouvent individuellement sursollicitées pour des tâches collectives, non gratifiantes en particulier pour la carrière. Le résultat est en définitive contraire à l’objectif d’équité recherché.
Il conviendrait plutôt de se préoccuper des fondations, c’est-à-dire des conditions d’accès aux carrières de l’université et de la recherche. Des mesures incitatives pourraient être envisagées pour favoriser le recrutement des jeunes femmes : financement d’accueil qui s’ajouterait à celui existant déjà, attribution d’une bourse de thèse dans les deux ans de la prise de fonction… Mesures justifiées également par les inégalités en termes d’horloge biologique. Et surtout, afin d’objectiver ces questions de biais de genre, il faut des recueils de données genrées, sur les carrières, les conditions de travail : Nancy Hopkins dans le documentaire Picture a scientist montre que les surfaces de laboratoire allouées aux professeures étaient, au MIT, nettement plus faibles que celles accordées aux professeurs !
Bref, les évolutions, même si elles vont dans le bon sens, restent très lentes. Une étude récente du ministère estime que, si l’on maintient le rythme actuel, l’égalité femmes/hommes au sein de l’ESR, bien que priorité inscrite dans la loi, ne sera atteinte qu’en 2068. Il est urgent d’agir !![]()
Clotilde Policar, Professeure, directrice des études sciences à l’ENS, École normale supérieure (ENS) – PSL et Charlotte Jacquemot, Chercheuse en sciences cognitives, directrice du département d’études cognitives à l’Ecole normale supérieure, École normale supérieure (ENS) – PSL
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.