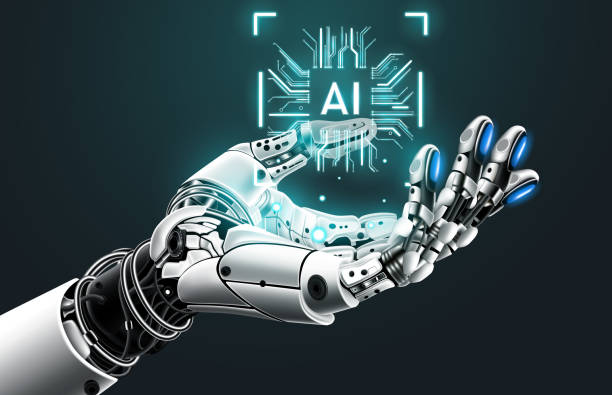Depuis que son œuvre, ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’ a été sacré, le 3 novembre dernier au célèbre restaurant parisien Drouant par le jury du plus prestigieux prix littéraire français, le Goncourt, le nom de Mohamed Mbougar Sarr est sur toutes les lèvres, claviers et plumes. Félicité pour ses talents d’écriture, adulé, mais aussi critiqué et caricaturé, le Goncourt 2021 n’en est pas pour autant choqué. A 31 ans, cet ancien de la prestigieuse Ecole des hautes études en sciences sociales, ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis, Meilleur élève du Sénégal en 2009, garde les pieds sur terre. Droit dans ses bottes ! Dans cette interview, Mohamed Mbougar Sarr revient sur le blanc entre les lignes de son livre, évoque les exigences et sacrifices de tout écrivain digne de ce nom, du nécessaire décalage entre la création littéraire, libre et ouverte, et les contraintes de la société. Homosexualité, rapports avec ses aînés en littérature, son identité plurielle, la relation France-Afrique sous l’angle de la contestation jeune, son élévation au grade de commandeur de l’ordre national du Lion à 31 ans seulement. Mohamed Mbougar Sarr sans tabou ! En toute liberté !
Vous venez de remporter le prix Goncourt avec votre livre ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’. Que représente-t-il pour vous ?
C’est tout d’abord une joie, celle de recevoir une récompense littéraire dont le prestige tient à son ancienneté, à son rayonnement et à la liste de ses récipiendaires. Mais c’est surtout un encouragement. Le Goncourt ne représente pas, à mes yeux, une consécration ultime, au sens où il viendrait couronner une œuvre finie, close. Je le reçois comme une distinction qui me dit : ‘’Continue à travailler, continue à chercher.’’ En toute simplicité, mais en toute joie.
Ce livre n’est pas le premier. Selon vous, qu’est-ce qu’il a de plus que les autres pour mériter cet accueil ?
Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Les lecteurs jugeront. Tout ce que je peux dire à ce propos, c’est qu’une ‘’œuvre’’ s’élabore dans un temps long, se bâtit selon une logique et un mouvement souterrains, dont l’auteur n’est pas toujours conscient, bien qu’il en soit l’agent, la main. Le plus important pour moi est cette cohérence interne, cette unité profonde dans laquelle je cherche à tenir tous mes livres, au-delà de leurs différences apparentes, stylistiques ou thématiques. Mes précédents romans ont aussi obtenu des prix. Pourquoi ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’ a-t-il été distingué par le plus connu d’entre eux dans l’espace francophone, le Goncourt ? J’imagine que c’est un mélange de beaucoup de paramètres, mais le plus essentiel, pour moi, je l’espère, est celui-ci : c’est d’abord un roman auquel un jury légitime a reconnu une certaine valeur littéraire, indépendamment de toutes les autres considérations, réelles ou fantasmées.
Dites-nous la muse qui vous inspire ? Famille, enfance, l’exil ? Comment faites-vous pour être si fécond ?
Je ne crois pas être excessivement fécond, mais seulement régulier. L’écriture est ma vie. A compter de ce moment, tout ce qui fait ma vie devient la source de mon écriture. Par vie, je n’entends pas nécessairement ma biographie ou les événements et petites histoires de mon quotidien, qui sont somme toute anecdotiques et sans grand intérêt pour les autres. Non : par vie, je parle de ma vie intérieure, que nourrissent en effet mon enfance sénégalaise, mon identité sérère, mes lectures, mes questions, mes obsessions, mes angoisses, mes désirs. Mais j’essaie aussi d’être attentif au monde qui m’entoure, aux autres, à ma société – la société sénégalaise – à ses espoirs et à ses contradictions, à son histoire. Être présent à soi et être présent au monde ; être dehors et être dedans. Voilà ce qui m’anime. Et la lecture, bien sûr : la suprême inspiratrice, la muse, c’est la lecture des grands écrivains, ceux qui vous poussent à écrire autant qu’ils vous désespèrent devant l’écriture.
Vous avez une écriture déroutante, souvent provocatrice, impertinente et allégorique aussi. D’où vous vient ce style particulier ?
Il y a, quant au style, des écritures bien plus déroutantes, baroques, oniriques, complexes, en comparaison desquelles la mienne paraît bien tranquille. Un style aussi se travaille dans le temps. Il ne se découvre, ni ne se maîtrise aisément. J’ignore si j’ai encore pleinement trouvé le mien, mais j’essaie de toujours maintenir une tension quant à sa recherche. Difficile de définir ce qu’est un style, plus encore quand il est question du sien propre ; mais il me paraît essentiel, dans le travail du style, d’être conscient des langues qu’on porte et de la manière dont on les ‘’fond’’ pour chercher ‘’sa’’ langue – sa langue personnelle d’écrivain, qui n’est ni le sérère, ni le wolof, ni le français ou l’anglais ou l’espagnol ou le lingala, mais une coprésence de toutes celles-là, c’est-à-dire de tout l’imaginaire que chacune d’elles charrie.
Travailler son style, c’est aussi (pardon pour la pompe de cette formule) travailler sa vision du monde. Cela signifie : essayer de toujours convoquer une certaine acuité dans sa manière de voir et sentir les choses et les êtres ; refuser la banalité ; rejeter la complaisance et la médiocrité ; toujours beaucoup exiger de soi ; n’avoir aucune pitié pour ses propres tentations de céder à la facilité (ou à une ‘’simplicité’’ qui serait une de ses ruses) ; prendre des risques lorsqu’il s’agit de chercher la vérité – la sienne, du moins. Une vérité poétique. C’est tout cela, je suppose, qui transparaît dans un style. Le mien est un effort vers la tenue de ces impératifs. Je ne dis pas que j’y parviens toujours. Mais je tente.
Que représente le personnage central de votre livre, Elimane ? Le saltigue Serer en pays blanc ? Vous-même ? Et Siga, également omniprésente, qui vous a aidé à suivre les traces d’Elimane ?
Elimane peut être la métaphore de beaucoup de choses : du silence de l’écrivain, de la quête du livre ultime, des ambiguïtés de l’histoire coloniale, de la tragédie du déchirement identitaire, du désir de s’anéantir dans la littérature, du désir du voyage, c’est-à-dire de trouver du nouveau ou d’avoir de nouveaux yeux… Elimane est surtout la métaphore de l’écrivain solidaire de son œuvre jusque dans la plus profonde des solitudes.
Quant à Siga D., je pourrais dire qu’elle est la maîtresse de Diégane Faye, aux deux sens du mot maîtresse.
Comment vous positionnez-vous par rapport à vos aînés, frères et sœurs de plume ? Vous êtes dans une logique de rupture, de continuité ou simplement sur votre propre chemin ?
On ne peut que tenter de suivre son propre chemin en littérature. Mais ce chemin singulier est à l’intérieur d’un chemin plus grand, que constituent tous les chemins qu’ont emprunté ou tracé les écrivains qui ont écrit avant soi. C’est une image de mon rapport aux aînés ou aux écrivains de ma génération : la solidarité sur le chemin de la littérature, la solitude sur le chemin de la littérature. Certains se perdent en chemin ; d’autres aboutissent à des impasses, quelques-uns vont loin, il y en a qui abandonnent ou se noient dans de profondes ornières. Mais au-delà des différences de démarches esthétiques, nous tentons tous de nous rattacher à une grande bibliothèque, d’aller vers la grande bibliothèque.
Votre position sur l’homosexualité est qualifiée de pas claire, selon certains commentaires lus dans les réseaux sociaux qui confondent d’ailleurs souvent ‘’De purs hommes’’ à votre dernier ouvrage. Les avez-vous vus ? Choqué ? Où avez-vous le sentiment d’être simplement incompris ?
Chacun est libre de penser ce qu’il veut de moi ou, plus intéressant encore, de mes romans, s’il se donne la peine de les lire vraiment. Une fois un livre écrit, je donne le minimum d’explications à son sujet, puisqu’il faut laisser vierge un espace d’intelligence, qui est aussi celui de la liberté d’opinion, au lectorat qui lit. Un écrivain ne doit jamais trop s’expliquer hors de ses livres, sous peine de finir humilié et exténué, sommé par tout le monde de justifier ou commenter chaque phrase, chaque mot, chaque métaphore, ce qui pourrait se rapprocher d’une définition exacte de l’Enfer. Les deux seuls tribunaux de l’écrivain sont sa conscience, d’une part, et d’autre part, les œuvres qu’il admire.
En face de la Société ou de la Morale, je suppose que l’écrivain doit quelquefois subir et assumer les malentendus, parfois essuyer la colère, voire la haine, mais toujours rester le plus près possible de son pays le plus profond : la bibliothèque. Je rappellerai trois choses : d’abord, le roman n’est pas un espace idéologique, mais un espace de fiction, de liberté et de questionnements. Ensuite, employer la forme romanesque pour ‘’parler’’ d’un sujet, même tabou à l’intérieur d’une société, ne signifie pas le promouvoir ou le défendre ou l’encourager, mais l’interroger, en questionner les implications politiques, philosophiques et existentielles par la fiction. Enfin, la liberté et l’indépendance dans la création sont des valeurs sacrées pour un écrivain. Cette liberté-là, celle d’interroger, est la mienne : ma liberté d’écrivain. J’ai toujours été libre et indépendant dans l’écriture ; je le demeure et espère le demeurer.
Faites-vous partie des écrivains qui pensent que la littérature donne tous les droits, y compris de transgresser par la plume certains interdits ?
Transgresser par la provocation ou l’outrance verbale est une chose facile. Choquer par l’effet éblouissant de phrases vulgairement clinquantes est facile. C’est à la portée du premier faiseur ou phraseur venu. Mais une fois que l’effet artificiel s’estompe, que reste-t-il vraiment ? Il existe un appel à la réflexion, à la confrontation avec ses limites morales, au face-à-face avec notre part d’ombre. Cet appel vient de plus loin : du cœur même de l’écriture, du cœur même du langage, et non de son vernis superficiel. Cela est la vraie transgression : essayer, par le langage littéraire, de toucher à tout ce qui semble intouchable dans l’esprit humain. L’écrivain, à mon sens, doit disposer de cette liberté-là. Elle lui est absolument nécessaire pour montrer à la société ses plaies, se tenir dedans, tendre un miroir au corps social pour qu’il voie les hideurs et les purulences qui peuvent le gangréner et qu’il dissimule, refuse de voir, grime parfois au grand jour en valeurs ou vertus qu’elle s’empresse de transgresser elle-même l’ombre venue.
A quoi sert un écrivain, un artiste, s’il ne fait rien bouger en nous ? S’il ne nous montre pas l’ombre en nous ? S’il ne nous indique rien qui, même un peu, nous effraie en nous ? C’est un enjeu à la fois esthétique et politique. Un écrivain est aussi un être social. Comme tel, je ne crois pas qu’il doive avoir tous les droits – il serait alors un tyran potentiel. Mais il me semble qu’il est responsable de la quête de vérités humaines cachées, et que seul le langage littéraire peut faire affleurer. Cette quête ne peut se faire qu’avec le maximum de liberté et en toute indépendance à l’égard de la morale. Evidemment, et c’est normal, la morale et la société se défendent et ne se laissent pas faire. L’artiste le paie parfois au prix fort. L’art veut gagner son autonomie ; la société veut son garder son autorité. C’est une dialectique ancienne.
Pour prestigieux que soit le Prix Goncourt, certains ne manqueront pas de voir dans toute célébration excessive le signe d’un certain complexe que vous évoquez d’ailleurs dans certaines de vos œuvres.
Je travaille et écris en toute indépendance. La solitude et la bibliothèque sont mes seules véritables alliées. On me récompense, je crois, pour la qualité que je tente de garder dans ce travail et qui me coûte cher en temps, en efforts, en vie sociale, en confort matériel. Si certains croient le contraire, pensent qu’il s’agit d’un complexe, libre à eux. Le plus important, ce sont les livres : ceux à lire, ceux à écrire.
On peut supposer qu’il faut être très discipliné pour pouvoir écrire et bien écrire autant de pages (plus de 400 pour le livré primé) ? Vous écrivez donc jour et nuit ?
Je suis bien obligé de le faire. J’écrivais plutôt la nuit jusqu’à une date récente. Aujourd’hui, je suis obligé d’apprendre à écrire partout et à tout moment. Mais vous avez raison de rappeler qu’écrire n’est pas une plaisanterie ou simple passe-temps : c’est un engagement éthique et existentiel fort. Cela demande discipline, sacrifice, courage, abnégation, sueur. Tout cela va avec la joie d’écrire.
Les relations entre la France et ses anciennes colonies ne sont plus ce qu’elles étaient. Disons qu’elles sont tendues, avec surtout la frange dite jeune du continent. Comment entrevoyez-vous l’avenir de cette relation, en tant que jeune écrivain utilisant la langue française comme véhicule d’expression ?
La langue française est aussi ma langue, à côté du sérère ou du wolof, par exemple. J’écrirai un jour dans ces langues sénégalaises. En attendant de mieux me former à leur écriture littéraire, j’écris en français sans complexe, sans déchirure, sans obséquiosité, sans sentiment de me trahir ou d’être amputé, sans impression de renoncer à une part de ce que je suis.
Quant à la relation entre la France et ses anciennes colonies, tout ou presque est réuni à la base pour qu’elle change, soit moins dissymétrique et moins néocoloniale. Il ne manque peut-être que des leaders politiques plus courageux pour effectuer le basculement décisif pour le rééquilibrage des relations. Ces leaders, j’espère, viendront et travailleront au service de leurs peuples avec intégrité, talent et humanité, sans esprit de revanche, ni populisme, en tirant les leçons qu’il faut de l’histoire.
Que pensez-vous du mouvement de plus en plus affirmé de rejet de la France dans l’espace subsaharien par les jeunes ?
On peut le rattacher à une tradition ancienne de luttes anticolonialistes, indépendantistes et anti-impérialistes. Ces mouvements ne s’adressent pas seulement à la France, mais aussi aux élites corrompues et aux pouvoirs antidémocratiques du continent. Il faut écouter, par-delà leurs manifestations spectaculaires ou agressives, ce que ces mouvements disent de la jeunesse du continent, ce qu’ils disent de leurs aspirations, ce qu’ils disent surtout de leur désespoir. Leur désir de repenser la relation est légitime. Ce travail de restructuration doit sans doute compter un ‘’moment’’ radical, dégagiste, qui consiste à appeler à une rupture totale avec l’ancienne puissance colonisatrice.
Mais il me semble que ce moment n’est précisément qu’un moment, en plus de ne pas être la seule voie possible. Il devra, tôt ou tard, et sans démagogie, ni populisme facile, passer à une autre étape où il ne s’agira plus de seulement s’opposer, mais de construire ou reconstruire sur le continent d’abord, et ses relations ensuite, en toute dignité.
Le président Macky Sall vous a élevé au rang de commandeur de l’ordre national du Lion, alors que vous n’avez que 31 ans. Comment avez-vous accueilli cela ?
J’ai reçu cet honneur avec gratitude et humilité. Ma mère a pu assister à ce moment, j’ai pu lire de la fierté et de la joie dans son regard, et c’est ce qui me rend le plus heureux. Bien sûr, d’autres figures sénégalaises (littéraires ou autres) mériteraient cette médaille autant, sinon plus que moi. Je pense à elles. Mais je suis touché par cette marque de reconnaissance du président de la République. Je crois qu’au-delà de ma personne, c’est simplement la réaffirmation de la culture sénégalaise comme l’un des piliers du pays, depuis longtemps. Maintenant, je dois retourner au silence et à l’ombre, et faire mon métier : écrire.
PAR MAHMOUDOU WANE, Enquêteplus