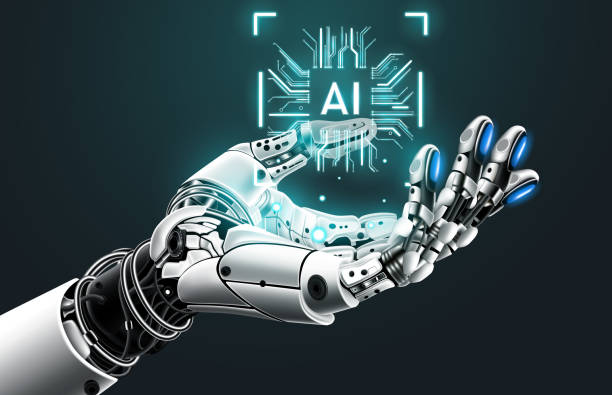A l’heure du Covid, l’écran s’érige comme un «masque de pixels» chargé de rendre viable la mesure de distanciation sociale. Mais la vigilance s’impose pour garantir la cohésion d’une société fracturée et en souffrance.
Du jour au lendemain, le confinement nous a imposé la nécessité de mener nombre de nos actions courantes, et de façon exclusive, en ligne. Le travail, l’école, l’université, les échanges usuels, bref, une large part de ce qui est nommé «vie sociale» s’est vu transposée en pixels.
De ces circonstances ont résulté trois effets. D’abord, une extrême intensification de l’usage de nos protocoles numériques. Ensuite, son extension à de nombreuses activités, dont on ne supposait pas pour certaines d’entre elles qu’il était raisonnablement possible de les mener ainsi : conseils d’administration, tenues de congrès, sommets de chefs d’Etat… jusqu’à des «apéros WhatsApp». Enfin, s’est formé un phénomène de naturalisation, comme s’il relevait dorénavant de la normalité de conduire toutes ces activités humaines à l’écart d’une présence charnelle partagée.
Du «présentiel» au «distanciel»
En cela, nous avons vécu un franchissement de seuil, témoignant de l’avènement d’une nouvelle condition, marquée du sceau d’un rapport toujours plus totalisant – particulièrement dans le monde du travail – entretenu avec les systèmes numériques. Certains, au nom de leurs intérêts, ont su propager une novlangue qualifiant la présence en commun de «présentiel», qu’il conviendrait désormais d’articuler – ou de substituer – avec le «distanciel», suivant une rhétorique vite banalisée laissant supposer que ce mouvement s’inscrit dans l’ordre par avance écrit des choses.
On s’est rendu compte au plus fort de l’épidémie que la qualité de l’infrastructure des réseaux et la capacité du personnel à bien user d’outils de communication – particulièrement Zoom de Google, facilitant les réunions en ligne –, pouvaient s’avérer plus déterminantes que la qualité d’un lieu et le fait de mener des tâches dans une présence commune. Ce constat constitue une rupture conceptuelle. Pour quelle raison faudrait-il maintenir certaines modalités alors que ces procédés ne cessent de prouver leur efficacité et que la situation appelle plus que jamais une réduction des coûts ?
A telle enseigne que Mark Zuckerberg a annoncé que les salariés de Facebook qui le souhaitent pourront télétravailler de manière permanente, parmi d’autres entreprises qui entendent généraliser ces usages. Tel l’assureur Allianz, qui veut encourager le «home office», ou de façon plus radicale, le Daily News qui a décidé de céder ses bureaux pour «devenir un journal sans rédaction physique». La nécessité d’opérer un «bon mix» entre le «présentiel» et le «distanciel» est devenue la nouvelle doxa. Or il faut avoir à l’esprit, et bien prendre garde, que partout où la seconde formule pourra détrôner la première, tout y conduira vu les gains induits, et ce particulièrement dans le secteur privé.
Un burn-out d’un nouveau genre
Le télétravail a entraîné, pour un grand nombre, des conditions d’exercice dégradées du fait d’un manque d’espace, de la présence conjointe de membres de la famille dans les domiciles, de l’impératif de naviguer entre plusieurs activités, particulièrement, celle d’assurer le soutien scolaire des enfants.
Un burn-out d’un nouveau genre a parfois été subi dû à un brouillage désorientant entre vies domestique et professionnelle empêchant une répartition distincte et équilibrée des tâches. La santé du travail s’est mise à se déporter vers l’intérieur des habitats. Se posent encore des questions dans le droit du travail liées à la propriété du matériel, à son usure, aux consommations énergétiques. Ne doit pas non plus être négligé l’impact écologique entraîné par une mise en réseau généralisée et ininterrompue.
Ce sont également des procédés de contrôle qui s’instituent sournoisement, opérant des «effets de zoom» sur les conduites. Tel le «télécran» à l’œuvre dans 1984 de George Orwell, mais en version 2020, permettant de savoir en temps réel si un employé exerce bien son activité, de quantifier les niveaux d’attention et de réactivité, et où chacun est à même d’être sollicité à tout moment. Ne peut alors que se produire une intériorisation du traçage de nos conduites, à l’instar des méthodes à l’œuvre dans les centres d’appel où les opérateurs sont continuellement soumis à évaluation via les outils utilisés, suivant un rêve réalisé de management ultra-optimisé maintenant étendu à une multitude de métiers.
Effacement des corps
Certes, ces techniques revêtent une apparence moins sensationnaliste que l’application StopCovid, qui a soulevé tant d’émotion, alors que c’est autrement pernicieux vu qu’ils sont appelés à pénétrer notre espace intime et à avoir cours au long du quotidien. Saisit-on la portée de ces enjeux juridiques et politiques en démocratie ?
Mais le plus crucial, c’est un phénomène à portée anthropologique et dont nous ne pouvons encore saisir toute la portée : l’instauration d’un nouveau paradigme dans les rapports interpersonnels. L’écran s’érigeant comme l’instance d’interférence majeure dans les relations. Comme si, en un éclair, nous avions vécu l’avènement d’un nouvel âge de l’humanité, voyant nos «masques de pixels» se charger de rendre viable la mesure de «distanciation sociale» que nous impose le coronavirus.
Un mouvement de fond a été enclenché, et il est probable qu’il ne s’arrêtera pas. Au moment où l’on assiste à des formes de surdité entre les différentes composantes du corps social, s’opèrent un effacement des corps et une médiatisation technicisée entre les êtres appelée à s’intensifier et qui pourrait vite prendre des allures ordinaires.
Le confinement n’a pas seulement représenté un événement biopolitique du fait de notre internement sanitaire obligé, ce fut autant un choc psychologique. Nous avons dû vivre, ex abrupto, nombre de situations à distance, ayant expérimenté une sorte de télé-socialité généralisée. Or, rien de moins naturel qu’une telle situation.
La norme du «sans contact» ?
Il convient de comprendre les rassemblements qui eurent lieu au cours de l’été à cette aune, comme un besoin irrépressible, et viscéralement humain, de proximité charnelle avec les autres, au sein d’une société promise à terme à ériger le «sans contact» comme la norme de conduite dominante.
Aujourd’hui, nous le savons, le virus est appelé à demeurer. Lors de la première vague épidémique, des usages s’étaient imposés par nécessité. Il va falloir qu’en cette rentrée, dans le monde du travail se tiennent des débats afin de conduire à des accords ne cédant pas à des solutions de facilité, de surcroît susceptibles par la suite d’être entérinées dans le long terme, et prenant en compte les situations singulières de toutes les parties concernées. C’est à ce titre que devraient être favorisés les récits d’expériences vécues lors du printemps dernier, dont nombre, à coup sûr, contrediraient les solutions clés en main, et souvent hors-sol, proposées par les cabinets de consulting.
Nous avons fait preuve de bien trop d’indolence à l’égard de l’industrie du numérique et de l’environnement qui, à grande vitesse, s’édifiait. Et nous l’avons, dans nombre de cas, payé au prix fort.
Alors qu’à l’«âge de l’accès» se substitue maintenant l’«âge de l’excès», nous devons exercer notre vigilance aux fins de sauvegarder nos principes fondamentaux. Au premier rang desquels, ceux permettant d’assurer notre indispensable cohésion – dans une société de partout fracturée et en souffrance – qui dépend pour large partie de liens fondés sur une sensibilité partagée.
Vu que certains acteurs économiques savent pleinement tirer profit du surgissement de catastrophes, ce ne serait ni faire de nous des «amish», ni des adeptes d’un «retour à la lampe à huile» que de nous opposer à la numérisation toujours plus intégrale de nos existences pour nous soucier plus que jamais, et en actes, d’une bonne (et vitale) écologie de nos relations.
Eric Sadin publiera le 7 octobre l’Ere de l’individu tyran. La fin d’un monde commun, aux éditions Grasset.
Publié d’abord dans Libération