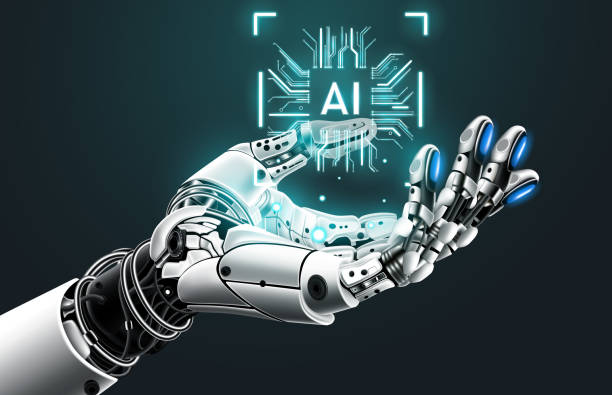L’écrivain et économiste sénégalais nous invite à en finir avec l’économie du « présentisme et de la démesure » qui a montré toutes ses limites durant la crise. La véritable croissance ne devrait pas faire décroître le vivant.
Face à la pandémie de coronavirus, Le Temps du Débat avait prévu en mars une série d’émissions spéciales « Coronavirus : une conversation mondiale » pour réfléchir aux enjeux de cette épidémie, en convoquant les savoirs et les créations des intellectuels, artistes et écrivains du monde entier. Cette série a dû prendre fin malheureusement après le premier épisode : « Qu’est-ce-que nous fait l’enfermement ? ». Nous avons donc décidé de continuer cette conversation mondiale en ligne en vous proposant chaque jour sur le site de France Culture le regard inédit d’un intellectuel étranger sur la crise que nous traversons. Depuis le 24 avril, Le Temps du débat est de retour à l’antenne, mais la conversation se poursuit, aussi, ici.
Aujourd’hui Felwine Sarr, économiste et écrivain sénégalais, professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et co-fondateur des Ateliers de la pensée de Dakar.
La crise du Covid-19 a mis à nu plusieurs failles du système économique néolibéral. Celles-ci sont apparues plus distinctement à la faveur de l’arrêt, pendant quelques mois, de la production industrielle mondiale. Au début de la pandémie, la première économie du monde, les États-Unis, était au plein-emploi (3.5% de chômage). En mai 2020, elle atteignait son niveau de chômage le plus élevé depuis la crise de 1929 (16,3%) [1] avec 20, 5 millions d’emplois détruits sur une population active de 156 millions d’individus. Il est apparu que l’organisation, la conception et les modalités du travail de notre système économique actuel induisent une précarisation généralisée des emplois dans la plupart des secteurs de la vie économique, et pas seulement de ceux relevant de l’économie dite informelle, dont la volatilité des revenus et l’absence de filets sociaux ont été rendues plus manifestes par la crise actuelle. Aussi bien dans l’aéronautique [2], la production de biens et services, que pour les secteurs du tourisme, de la culture, de la restauration, c’est une économie structurée autour d’une temporalité de court terme où la vie économique est financée par des recettes journalières, qui s’est révélée. Une telle économie a besoin d’une accumulation quotidienne et à la petite semaine de cash-flows pour faire face aux charges d’exploitation dues mensuellement et aux traites bancaires, surtout pour les PME. Les grandes firmes qui ont des lignes de crédit ouvertes dans les banques, financent une grande partie de leur activité par endettement. Lorsqu’elles anticipent une baisse de l’activité dans les mois à venir, elles licencient.
L’investissement et donc l’activité présente sont fortement liés à l’anticipation du futur. L’endettement étant un transfert des ressources du futur vers le présent, l’économie d’aujourd’hui est financée par les ressources de demain. Le système a une forte préférence pour le présent dont elle surpondère la valeur. Une telle économie vit au-dessus de ses moyens et entretient l’illusion de ses capacités et de sa puissance. Lorsque le futur devient incertain, celui-ci par rétroaction affecte le temps présent dont le niveau d’activité et de consommation dépendent.
Nous faisons l’expérience d’une économie qui pour produire des biens de consommation, souvent en excès, épuise la bio-capacité de la planète, surexploite ses ressources, entrave sa capacité à se régénérer et transfère des revenus futurs dans un temps présent. C’est une économie du présentisme, de la démesure, de la précarité généralisée et de l’étouffement. La repenser dans ses fondements structurels, ses modes de fonctionnements et ses finalités est vital pour la survie de nos sociétés.
Parmi les questions qu’elle soulève, figure celle de la rémunération du travail et de sa valeur. Les infirmières, les médecins, les caissières de supermarchés, les conducteurs d’autobus, tous les emplois liés aux soins ont révélé durant cette crise leur caractère essentiel pour la vie de nos sociétés, alors que ce sont les métiers les moins bien rémunérés par le système économique actuel, qui surpaye le capital, les intermédiaires, les bullshits jobs [3], les emplois des marchés captifs et sous-payent ceux qui contribuent à nourrir, à pérenniser et à soigner la vie [4]. Une réévaluation de la valeur marchande du travail et de sa rémunération pourrait être fondée sur sa contribution au maintien de la vie, à la préservation d’un environnement sain, à l’intelligence collective, à la production de savoirs et à la culture de l’esprit.
L’économie-monde est productrice d’inégalités entre les nations et à l’intérieur de celles-ci. Ces fractures sont apparues à plusieurs niveaux ; dans la faculté inégalitairement distribuée de disposer d’une épargne ou d’actifs qui permettent de traverser des moments difficiles, dans la possibilité d’accéder à des soins de qualité, mais également dans la différence de vulnérabilité des groupes humains selon l’historique des fragilités déjà constituées, notamment les comorbidités issues des conditions de vie difficiles. Ces inégalités sont liées au système de production de la valeur ajoutée de l’économie-monde et à ses modes de redistribution, aux règles du commerce international et à la division internationale du travail. Le système économique mondial est structurellement construit pour produire de l’inégalité et accélère l’entropie du vivant. Il faudra désarticuler cette architecture, refonder les institutions qui la sous-tendent, repenser leurs missions (OMC, Institutions Multilatérales, …) et inventer de nouveaux processus de régulation des relations macro et microéconomiques ; déconcentrer les pouvoirs et défaire les monopoles. Nous vivons dans un monde où un seul individu détient une richesse supérieure au PIB de 179 pays cumulés [5], ce qui représente 3,4 milliards d’individus et 43, 7 % de l’humanité. Voici l’étendue de la folie. Elle se passe de commentaires. Nous pourrions produire des règles qui plafonnent les richesses détenues par les individus, parce qu’à partir d’un certain seuil, une minorité pathologiquement accumulatrice, prive une majorité de ressources nécessaires à une vie digne ou limite ses possibilités d’y accéder.
La division internationale du travail a fait des nations émergentes et celles dites en développement des productrices de matières premières qui sont transformées dans des industries des pays du Nord. La valeur ajoutée est ainsi transférée des pays du Sud du Globe vers ceux dits du Nord. La convention est de mesurer la richesse produite en sommant les valeurs ajoutées produites annuellement. Ce concept de croissance du PIB ne prend pas en compte les coûts environnementaux, humains et sociaux de l’appareil productif mondial. Ici se pose la question de l’évaluation de la valeur de ce qui est produit, de son utilité et de son coût.
En réalité nous sommes dans des économies de la mal-croissance, fondées sur un faux système comptable qui omet de comptabiliser ses vrais coûts et nomme inadéquatement ses actifs et ses passifs. Le prix de nos produits devrait intégrer leur coût environnemental et refléter leur contenu en carbone. Ce que nous appelons croissance économique, fait décroitre le vivant. Le système économique actuel en favorise l’entropie. Nous surpayons une production d’objets dont certains sont superflus et futiles, et ne servent qu’à entretenir des industries à un coût exorbitant pour la planète.
Une économie du vivant serait fondée sur une réévaluation de l’utilité de tous les secteurs de la vie économique au regard de leur contribution à la santé, au soin, au bien-être, à la préservation du vivant et à la pérennisation de la vie, à la cohésion sociale. C’est ce qu’ Isabelle Delanauy appelle une économie symbiotique, c’est-à-dire une économie dont le métabolisme n’affecte pas négativement les ordres sociaux, environnementaux et relationnels. Il ne s’agit pas ici de prôner une limitation de la vie économique à la satisfaction des besoins biologiques fondamentaux : se nourrir, se soigner, se vêtir. Les besoins de l’esprit et de la culture sont aussi essentiels à nos sociétés, mais de se poser la question de l’utilité et de la nécessité des biens produits, de leur mode de production et de leurs impacts sociaux et environnementaux. On ne pourra plus se payer le luxe de ne pas interroger la finalité de la vie économique ainsi que ses modes de production ; ni de l’inscrire dans une cosmopolitique du vivant.
[1] Données du Bureau of Labor and Statistics, (BLS) USA
[2] Air Canada a licencié 70 % de ses salariés. Air France a eu besoin d’une injection de 7 milliards d’euros de la part de l’État Français et Néerlandais pour faire face aux effets de la crise. L’État Allemand est entré dans le capital de la Lufthansa avec un investissement de 3 milliards d’euros.
[3] Voir David Graeber, Bullshit Jobs (2018, éditions les Liens qui Libèrent)
[4] La France discute actuellement (Ségur de la Santé) d’une revalorisation salariale des personnels soignants dont on s’est rendu compte de l’importance de la contribution durant la crise sanitaire.
[5] M. Bezos, le patron de Amazon dont la fortune pourrait dépasser 1000 milliards de dollars en 2026, d’après le média américain Esquire.
Emmanuel Laurentin avec l’équipe du « Temps du débat ».
Franceculture